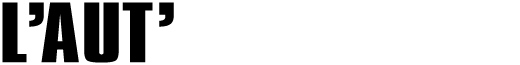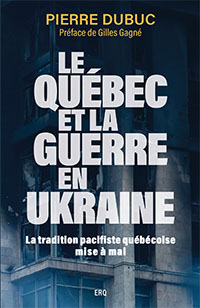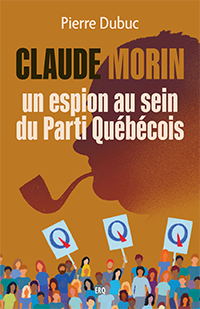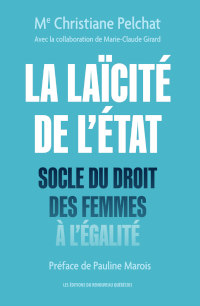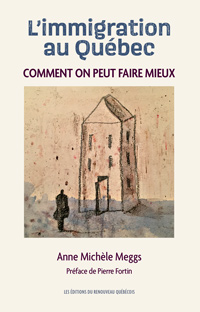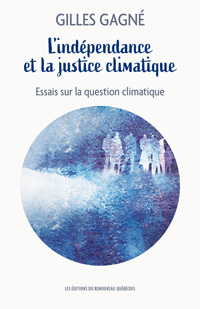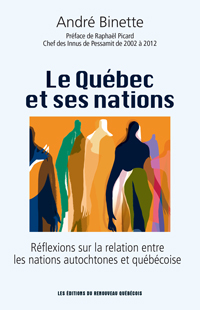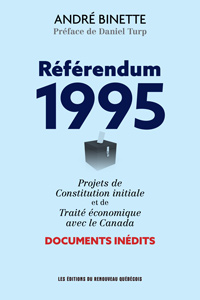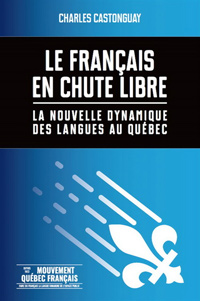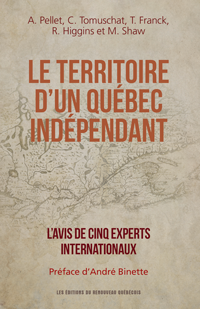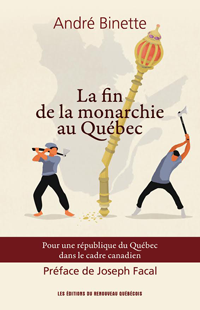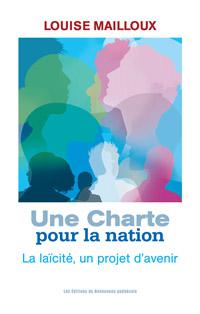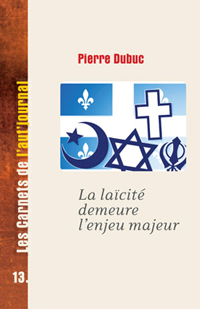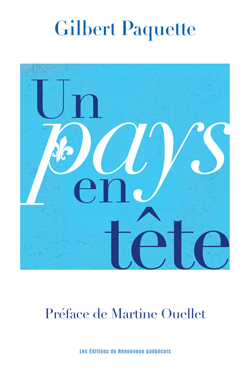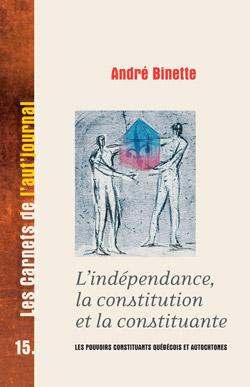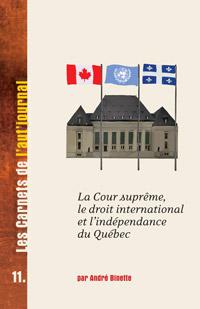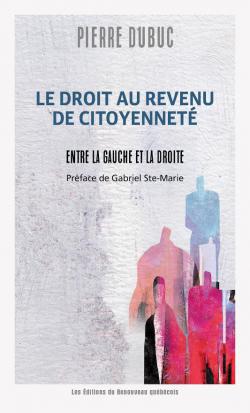- Pierre Dubuc
En guise de réponse à Pierre Falardeau et à Michel Rioux
Lancé lors de l'assemblée de la Coalition souverainiste du 2 décembre dernier, le débat sur l'alliance des forces souverainistes est bel et bien enclenché. Rappelons qu'à cette occasion, en réponse à notre discours qui – soulignant la diversité des opinions dans le camp souverainiste – prônait le scrutin proportionnel comme seul moyen d'unir les forces indépendantistes de toutes allégeances, Pierre Falardeau avait répondu par un tonitruant 0 « Le projet de société, je n'en ai rien à cirer » (voir l'aut'journal no. 205).
Dans le numéro de janvier 2001 du journal indépendantiste Le Couac, les chroniqueurs Michel Rioux, Pierre de Bellefeuille et Pierre Falardeau reviennent sur le sujet.
L'œuf ou la poule ?
Michel Rioux pose la question 0 l'œuf ou la poule? « La poule, écrit Rioux, c'est l'indépendance nécessaire. L'œuf, c'est le projet de société chargé de donner à l'indépendance sa consistance. » L'œuf ou la poule ? Rioux prend position en faveur de la poule 0 «Constatons avec Pierre Falardeau qu'à varger à temps et à contretemps sur la poule pour qu'elle livre un œuf pur et dur, la poule risque de finir par ne plus être en mesure de le pondre, son œuf. »
Le débat entre « l'œuf et la poule » n'est pas nouveau. Michel Rioux écrit que c'est « la question existentielle sur laquelle ont trébuché maintenant trois générations d'indépendantistes québécois ». Dans l'abstrait, il peut sembler en être ainsi, mais une lecture plus attentive de l'histoire démontre que les indépendantistes ont trouvé, aux différents moments clefs de leur histoire, des moyens originaux de résoudre concrètement la question.
Comment fut résolue, en 1980, la contradiction entre l'œuf et la poule
Au cours de la période qui va de la création du Parti québécois en 1968 jusqu'au référendum de 1980, la contradiction s'est résolue à l'intérieur même du PQ. Avec un membership de près de 300 000 membres en 1980, le PQ était une vaste coalition au sein de laquelle la gauche était bien représentée avec des députés issus du mouvement syndical ou progressistes comme Robert Burns, Robert Bisaillon, Pierre Marois, Denis Lazure, Lise Payette, Jacques Couture, Gilbert Paquette.
Les mesures progressistes adoptées lors du premier mandat péquiste (assurance-automobile, loi anti-scab, loi 101, réforme du financement des partis politiques, etc.) en témoignent, tout comme les campagnes menées contre cette gauche par une droite qui cherchait à la tourner en dérision avec le vocable de go-gauche.
On argumentera qu'il y avait une gauche marxiste-léniniste à l'extérieur du Parti québécois, mais faut-il rappeler que cette gauche était fédéraliste et que nous discutons ici de la coalition des forces souverainistes. Il existait, malgré tout en 1980, une gauche marxiste indépendantiste hors du PQ, mais son audience était insignifiante. La gauche souverainiste était au Parti québécois.
La coalition souverainiste, regroupée à l'intérieur du Parti québécois, a commencé à s'effriter après l'échec référendaire. C'était normal. Tout échec provoque des remises en question. Mais c'est bel et bien lors des négociations du Front commun en 1982 - alors que le gouvernement Lévesque a réduit les salaires de la fonction publique de 20 % - que la coalition a éclaté. À partir de ce moment-là, le PQ n'allait plus pouvoir rassembler en son sein le large éventail politique des forces souverainistes.
Le cocorico de 1995
Quand le Parti québécois a repris le pouvoir en 1994, avec la promesse d'un référendum en 1995, s'est posée la question de la reconstitution de la coalition souverainiste entre les partisans de l'œuf et ceux de la poule.
Cette fois, la contradiction a été résolue à l'extérieur du PQ avec la création des Partenaires pour la souveraineté où se sont retrouvés, pour coordonner leurs actions, les partis politiques (PQ et Bloc), les organisations syndicales, étudiantes, féministes, les artistes. Saluons le génie politique qui a accouché de cette forme organisationnelle qui a permis une mobilisation telle qu'elle nous a quasiment procuré la victoire.
Soulignons au passage qu'en 1980, un regroupement comme les Partenaires pour la souveraineté n'aurait pas été possible parce que plusieurs organisations n'avaient pas le mandat de leurs membres pour promouvoir la souveraineté. C'était le cas, entre autres, de la CEQ et de la CSN.
L'échec du référendum, le départ de Jacques Parizeau, l'arrivée de Lucien Bouchard, un ex-ministre conservateur, le Sommet du Déficit Zéro et ses conséquences désastreuses ont élargi le fossé entre le Parti québécois et les organisations syndicales et sociales. La poule a perdu tellement de plumes qu'elle est méconnaissable. Elle est devenue si peu fréquentable qu'il serait extrêmement difficile aujourd'hui pour plusieurs organisations syndicales d'obtenir un mandat de leurs membres pour siéger aux côtés du Parti québécois sur un organisme similaire à ce que furent les Partenaires pour la souveraineté.
Avec le scrutin proportionnel, la réconciliation de l'œuf et la poule
Dans son discours à l'assemblée du 2 décembre, Bernard Landry soulignait que, pour la première fois de son histoire, la souveraineté était plus populaire dans les sondages que le Parti québécois. Cela témoigne certes des progrès immenses de l'idée d'indépendance, mais également de l'essoufflement du parti qui en a été le principal porteur.
La popularité croissante du scrutin proportionnel, une idée relancée il y a à peine deux ans dans les pages de l'aut'journal, est un signe d'un changement profond des mentalités. La diversité des opinions politiques cherche maintenant à s'exprimer directement sur la scène politique et électorale. Soulignons que des organisations aussi importantes que la CSQ et le conseil central de Montréal de la CSN ont adopté dernièrement des positions de congrès en faveur de la réforme du mode de scrutin et que c'est par ce biais que se fait aujourd'hui le débat sur leur implication dans l'arène politique.
Le scrutin proportionnel, riche en alliances politiques potentielles, est fort probablement la forme nouvelle dans laquelle se forgera la coalition des forces souverainistes. Le premier ministre Landry a annoncé la création d'une commission parlementaire itinérante sur la réforme du mode de scrutin. Nous ne pouvons présumer de ses conclusions. Toutefois, il faut mettre en garde le gouvernement contre une approche qui chercherait à rallier le vote de gauche lors des prochaines élections avec la promesse d'une réforme du mode de scrutin au cours d'un prochain mandat.
« La patrie avant les partis », nous dit Landry
Le PQ devra procéder à cette réforme avant les prochaines élections ou, si cela s'avère impossible, donner des garanties de sa bonne foi en cédant des comtés sûrs à des candidats de la gauche ou du mouvement syndical et en invitant ses membres à les appuyer. On pourrait penser, à titre d'exemple, à un appui à une candidature Cliche dans Mercier, Michel Chartrand dans Jonquière, Roméo Bouchard de l'Union paysanne dans Kamouraska ou encore Françoise David dans un autre comté. Ces candidatures pourraient être sous la bannière de l'Union des forces progressistes si une telle force voit finalement le jour.
Une tel geste enverrait un message clair que la direction du PQ réalise qu'elle ne peut plus regrouper en son sein l'ensemble des forces souverainistes et qu'elle accepte de placer l'indépendance au-dessus de l'intérêt de parti. « La patrie avant les partis aime à répéter Bernard Landry », nous dit son biographe Michel Vastel. L'occasion se présente de le démontrer.