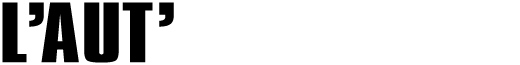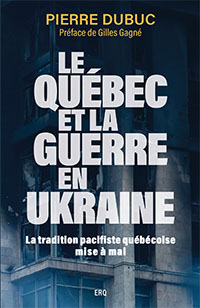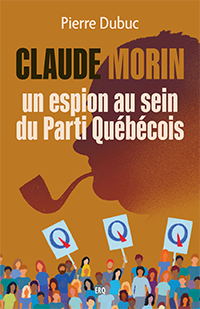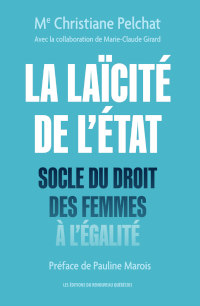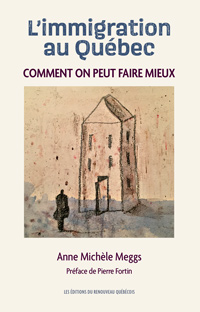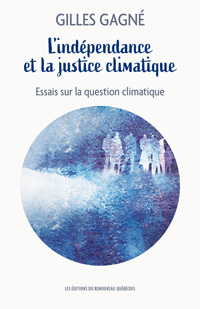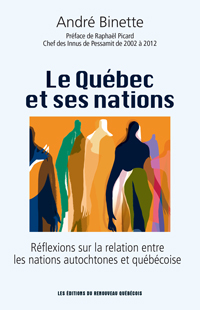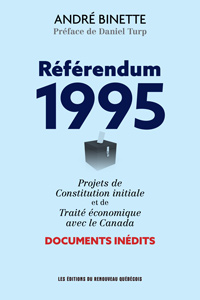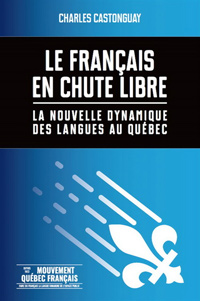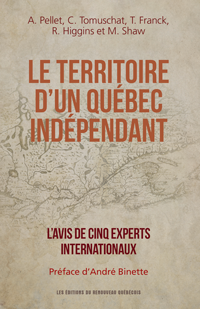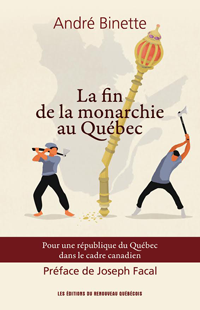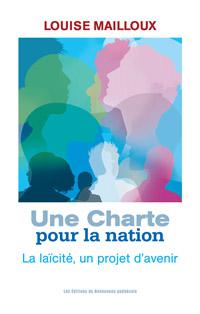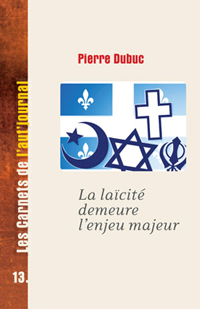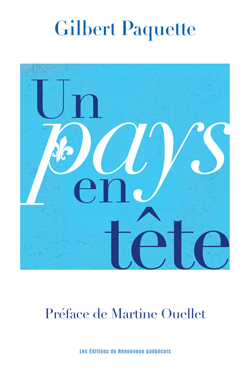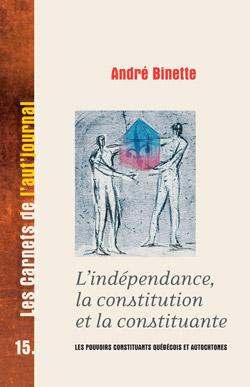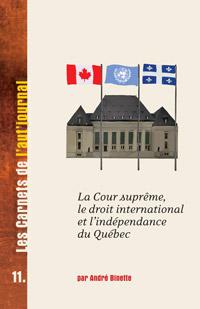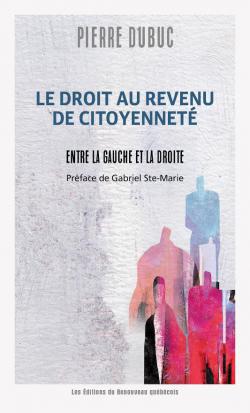Patricio Henriquez n’a pas un parcours ordinaire. En moins de quatre petites années, sans jamais trahir ses convictions politiques, il est passé du statut de révolutionnaire sous Allende à traître et prisonnier sous Pinochet, puis est devenu réfugié politique au Québec. Après y avoir pratiqué les « emplois d’immigrés » pendant un temps, il trouve du côté du cinéma et de la télévision un domaine où il a la chance de prendre position sur tous les fronts et ainsi faire coexister lutte politique et passion artistique. Portrait d’un réalisateur et producteur profondément engagé à propager les images d’un monde dur, mais rempli d’espérance et de solidarité.
En 1970, la société chilienne est en pleine transformation et revendique à pleins poumons la liberté, le juste partage de la richesse et l’égalité pour toutes et tous. Patricio Henriquez a alors 22 ans et étudie le journalisme à l’Université de Santiago. Militant de gauche, il s’engage dans la révolution et milite pour Salvador Allende qui se présente à la présidence pour une quatrième et décisive fois. Ainsi, pendant l`historique campagne électorale du candidat du Front d’action populaire, il est tour à tour journaliste, chauffeur, garde du corps et accompagnateur de Mme Allende.
Peu après la fracassante victoire du candidat socialiste, Henriquez devient son attaché de presse. C’est donc des premières loges qu’il vit ces années de révolution nationale, de réforme agraire, de nationalisation des mines, de lutte contre l’impérialisme et d’émancipation collective.
Puis, un certain 11 septembre 1973, sous les ordres du général Pinochet et l’appui pernicieux du gouvernement américain de Richard Nixon, le pays tombe sous la barbarie armée d’une poignée de sanguinaires d’extrême droite: « Le jour du coup d’État, je me suis rendu avec ma femme et quelques collègues à la radio qui transmettait les dernières paroles d’Allende. Là-bas, on nous a demandé de se rendre à l’antenne qui diffusait les ondes. Celle-ci se trouvait à quelques kilomètres de la ville. On voulait défendre coûte que coûte la radio du peuple. On nous a même distribué des armes. Quand les soldats sont arrivés pour la détruire, on leur a tiré dessus, mais comme on ne savait pas du tout comment manipuler ces armes, on a vite été maté puis arrêtés. Ce fut un geste stupide. J’aurais pu y laisser ma vie. Heureusement, le général avait des sympathies pour la gauche. Il a refusé de nous fusiller. Ils nous ont conduits au stade de Santiago.» .
Là-bas, dans ce stade transformé en gigantesque prison, totalement isolé du reste du monde, coupable d’avoir rêvé d’un monde meilleur, il croupira pendant plus de deux mois en compagnie de quelques 45 000 autres camarades.
« Comme tous les prisonniers, j’ai été questionné et torturé. Une torture qui se pratiquait en groupe et que la solidarité des autres prisonniers permettait de mieux subir. Plus tu es proche de l’ennemi, plus tu développes ta révolte, plus tu t’engages dans la lutte », raconte-t-il.
En sortant de prison, Henriquez était plus convaincu que jamais qu’il fallait riposter, qu’il fallait combattre la dictature: « Quand tu sors de prison, tu veux faire la révolution pour aider tes camarades qui y sont encore. Tu veux les faire sortir parce que tu sais ce qu’ils subissent. Mais peu à peu tu commences à avoir peur. Personne ne parle plus de politique. Sous la dictature, le pays entier devient une prison. Les gens ne veulent plus t’adresser la parole parce que tu es suspect aux yeux du régime, parce qu’on te suit et que les soldats arrêtent ceux à qui tu parles. Même tes anciens camarades de lutte font semblant de ne plus te reconnaître. Peu à peu, tu te rends compte que n’importe qui devient délateur et que tu pourrais retourner en prison. Finalement, tu ne veux pas revivre ce que tu y as vécu. J’ai eu peur et j’ai choisi l’exil. »
Quand tout dérape, partir…pour mieux revenir
« C’est un prêtre qui m’a poussé vers l’ambassade du Canada. J’avais entendu parler du FLQ, mais à part cela, je ne connaissais rien de ce pays. C’est arrivé par hasard ! » Henriquez visait plutôt Cuba, la France ou encore le Venezuela où il avait des amis. Mais le résistant en soutane lui fit bien comprendre « qu’il n’était pas une agence de voyage ». C’était à prendre ou à laisser !
Ce n’est que rendu à l’aéroport de Toronto qu’il a opté avec ses concitoyens pour le Québec: « Des prêtres québécois qui étaient venus au Chili, qui avaient pris part à notre révolution, nous ont convaincus d’aller au Québec où les luttes sociales et politiques prenaient de l’ampleur et où on se sentirait sûrement mieux. Mais les agents d’Immigration Canada insistaient pour nous envoyer loin dans les prairies. On a menacé de faire une conférence de presse: ils nous ont rapidement expédiés à Montréal en train », se rappelle-t-il avec le sourire.
Il arrive donc au Québec en 1974, convaincu que la dictature de Pinochet est sur le point de tomber et qu’il reviendra rapidement au Chili: « On était physiquement au Québec, mais notre tête était encore au Chili. On luttait pour le Chili, on pensait au Chili, on voulait retourner là-bas. On a rencontré des Québécois et des Québécoises extraordinaires qui nous ont aidés, qui étaient solidaires avec nous et qui en connaissaient beaucoup sur la situation politique de notre pays. La solidarité était incroyable. Mais, après un certain temps, je me suis rendu compte que le régime ne tomberait pas et que mes convictions politiques ne pouvaient s’exprimer par télépathie, qu’elles devaient s’ancrer à l’endroit où je me trouvais. J’ai commencé à vraiment défaire mes valises en 1978 avec l’intention de construire quelque chose ici. »
Chili-Québec, même combat
Pour Patricio Henriquez, le Québec est devenu plus qu’un lieu d’accueil: c’est devenu un terrain où il pouvait continuer la lutte pour le socialisme en s’affirmant comme indépendantiste: « Sachant qu’il existe un potentiel incroyable de changement social et des valeurs progressistes bien ancrées à l’intérieur du mouvement indépendantiste québécois, je crois que l’indépendance nationale serait un pas vers la bonne direction. Le lendemain d’un référendum gagnant, tout resterait possible et à construire », déclare-t-il.
L’indépendance du Québec n’est donc pas une chose qui lui fait peur &/48; « C’est une connerie que d’affirmer qu’un Québec indépendant se couperait soudainement du monde ! C’est justement quand ton identité est forte et assumée que tu t’ouvres à celui-ci. C’est quand tu n’es pas fort que tu te refermes. »
Ainsi, la phrase de Parizeau sur « l’argent et des votes ethniques » prononcée le soir du référendum de 1995 ne l’a pas du tout choqué: « Parizeau avait raison, c’était un constat politique. Du moment où une majorité de Québécois-e-s francophones considèrent qu’ils doivent se doter d’un pays, je crois que tout immigrant doit se poser de sérieuses questions et tenter de comprendre leurs motivations », conclut-il.
Les images d’une planète
Son combat, Henriquez le mène aujourd’hui en images. À titre aussi bien de producteur que de réalisateur, il utilise le documentaire social et politique pour conscientiser le plus grand nombre possible de citoyen-ne-s.
En 1998 et 1999 il réalise deux documentaires percutants: Les derniers jours de Salvador Allende, qui raconte heure par heure le coup d’État de 1973 et Images d’une dictature, qui, à l’aide d’une suite d’événements non commentés, dévoile l’inhumanité de la répression et l’injustifiable logique de la dictature, mais surtout la lutte acharnée des Chiliens et Chiliennes pour la liberté: « J’étais tanné de faire des films où on était perdant. Dans ce film, je voulais montrer la progression de la lutte contre la dictature. Au début, les gens avaient trop peur mais, peu à peu, ils ont repris possession de la rue. Sans cette lutte, qui s’est gagnée millimètre par millimètre, la dictature n’aurait jamais cédée. Pour moi, c’est un film de victoire. Je voulais que les gens comprennent qu’il est possible de se révolter. » .
Après avoir réalisé une série télévisuelle sur les grandes villes du monde (Vivre en ville), il travaille actuellement sur une série qui se concentre sur les travers sociaux qui sévissent un peu partout sur la planète (ce qui inclut l’Occident): « On ne fait pas de films pour réconforter les gens. On montre des injustices qui s’exécutent loin, mais aussi près de nous, dans nos pays occidentaux. Il ne faut surtout pas que les gens se disent “ qu’est-ce qu’on est bien ici après tout, on a pas ces problèmes ! ”. De plus, en étant diffusé dans le sud, on leur montre que tout n’est pas aussi parfait que certains le prétendent, qu’il y a ici aussi de la misère et de graves problèmes sociaux. »
Dans cette série (Extremis), il a été question des problèmes de l’esclavage moderne, de la pollution de la planète, de l’enfance assassinée (des enfants qui travaillent), des disparitions (politiques et autres) et de la peine de mort. Ce dernier documentaire qui suit la famille d’un Américain condamné à mort et raconte l’histoire d’un Japonais faussement accusé, montre avec beaucoup de force et d’humanité la barbarie d’une telle mesure encore pratiquée dans plusieurs dizaines de pays. Un film qui monte la cruauté même. Vous n’en sortirez pas indemne.
Ce documentaire sera diffusé à Télé-Québec le jeudi 27 février prochain à 20h00.
Pour plus de renseignements: macumba@macumbainternational.com Tél: (514) 521-8303