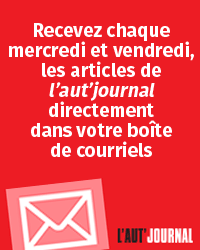Longueur de l’article : 2500 mots
Dans l’histoire des peuples, il arrive que des faits individuellement insignifiants, a priori divers, se joignent entre eux, s’agglutinent et offrent un véritable cliché photographique des grandes tendances qui les traversent. Au Québec, l’actualité récente nous a offert le portrait saisissant de notre assimilation.
En quelques jours, les événements déboulent. La firme MDC de consultation en immigration canadienne énonce, dans une publicité destinée aux migrants voulant s’établir dans l’ouest canadien, qu’un des désavantages du futur pays d’accueil se situe dans l’existence résiduelle du fait français, quelque part cloîtré dans l’est du territoire et disséminé chez quelques minorités. Il ne s’écoule que quelques heures pour que les propos incendiaires du professeur Amir Attaran prennent les proportions que l’on connaît. Le Québec est alors réduit à une entité structurant la suprématie blanche, comme ont pu le faire les États du sud étatsunien à l’époque de la ségrégation raciale.
La semaine suivante, une odieuse tuerie de masse s’abat sur des asiatiques d’Atlanta. Face à la montée d’une xénophobie anti-asiatique en contexte de pandémie, une manifestation montréalaise s’organise, en phase avec des mouvements de rue qui se sont multipliés en Amérique du nord au cri de «stop asian hate». Il n’en fallait pas plus pour que le chroniqueur Mathieu Bock-Côté dénonce cette propension à calquer sur le Québec les problèmes américains et à manifester en anglais.[1]
Quiconque côtoie un tant soit peu les milieux progressistes québécois sait que le type de nationalisme défendu par les gens de la trempe de Bock-Côté leur donne de l'urticaire. Beaucoup de progressistes sont prêt à s’opposer, bien que tièdement, au «Quebec bashing», sans pour autant faire le saut dans la critique des éléments «progressistes» du régime canadien. Certains dénoncent avec véhémence l’intolérance explicite contre les Canadiens-français du type de celle exprimée par le cabinet MDC, sans nécessairement lier cette intolérance aux propos du professeur «racisé» Attaran. Quant à l’idée de lier cette critique au fait que plusieurs minorités ethnoculturelles du Québec choisissent l’assimilation à la culture anglo-canadienne plutôt que l’intégration à la culture québécoise, la bienveillance progressiste les mènent bien souvent à se taire, même à dénoncer le «racisme» de ceux qui désignent ce problème. Pourtant, les éléments ici mentionnés se joignent entre eux dans une dynamique globale d’assimilation du fait français.
Une assimilation libérale
Lorsque l’on parle de domination coloniale, l’on a souvent en tête des cas d’extermination de masse ou de suprématie raciale explicite. L’on pense au Congo belge du roi Léopold ou aux conquêtes espagnoles et portugaises du sud de l’Amérique. Il arrive pourtant que la sujétion de populations s’inscrive dans le temps long, et de façon beaucoup plus subtile et insidieuse. Cette sujétion peut alors revêtir les habits de grands bienfaiteurs humanistes, et pourtant, dans les faits, réaliser l’inverse de l’émancipation humaine. Le choix de l’assimilation des «Canayens» par l’Empire britannique entre dans cette catégorie.
Lorsque lord Durham arriva en terres canadiennes afin de trouver une solution au problème national franco-canadien qui avait mené aux révoltes patriotes, il représentait la fine fleur intellectuelle du progressisme anglo-saxon du XIXe siècle. Il voulait faire de la minorité française d’Amérique des sujets de la couronne britannique comme les autres. L’atteinte de cet objectif passait par l’implantation des institutions parlementaires anglo-saxonnes et d’un système politico-juridique protégeant les droits individuels. Pour que ces deux institutions s’avèrent efficaces, elles devaient s’inscrire dans un contexte où il n’existe plus de distinctions culturelles fondamentales entre les sujets canadiens. Il fallait éliminer le fait français par une politique impériale d’assimilation. L’on a là l’exemple même d’un projet qui se présente comme démocratique et libéral et qui, du même coup, instaure une entreprise de nettoyage ethnoculturel. Le speak white anglais fut toujours «progressiste».
Après avoir réduit les Canadiens-français à la minorisation politique par l’Union du Haut et du Bas-Canada (français) et par l’affirmation d’un fédéralisme colonial dans la constitution de 1867, la tendance à l’assimilation libérale s’est accélérée à partir des années 1980. La Constitution de 1982 nie l’existence de peuples fondateurs et neutralise les lois linguistiques du Québec par l’imposition du bilinguisme institutionnel. Les Québécois sont menés à devenir une minorité parmi tant d’autres dans le melting-pot multiculturel de ce que Justin Trudeau proclame comme le premier «État post-national» au monde.[2] Les citoyens québécois dont la langue maternelle est le français passeront, selon les tendances démographiques actuelles, sous la barre de la majorité sociologique d’ici les années 2060.[3] Le projet de Durham se réalise sans que les «progressistes» et les «décoloniaux» ne s’insurgent.
Au contraire, ils encouragent un discours culpabilisateur contre les forces sociales qui résistent à cette déferlante culturelle et démographique. La résistance au choc de la Conquête et de ses suites a toujours été vue, dans le Canada anglais, comme une anomalie intolérable. L’attachement des Canadiens-français à leur culture et à leur langue était associé au «papisme», à la réaction, à l’arriération, à l’inculture, à l’analphabétisme, à l’autoritarisme, l’antilibéralisme et la xénophobie. Aujourd’hui, la conversion d’une part considérable de la gauche à l’intersectionnalisme assimile toute forme d’affirmation nationale des Québécois à la «blanchité», la suprématie raciale, la colonisation et même l’esclavage (!). Dans un processus pervers de contradictions et d’inversion accusatoire, l’assimilation revêt le masque de l’antiracisme. En matière de langue, de culture et de laïcité, l’on en vient à justifier la mise en tutelle de ce peuple de demeurés et sa prise en charge par les tribunaux fédéraux.
Le discours haineux d’Attaran est en parfaite adéquation avec l’état mental du camp progressiste. Ceux qui ne font pas le lien entre ce professeur et le racisme anti-québécois font habituellement parti du problème et s’agrègent férocement aux forces assimilationnistes. C’est, depuis un moment, le cas du NPD qui, sous Jaghmeet Singh, s’est converti au racialisme américain. Singh accepte, dans son camp, que des gens «racisés» adhèrent aux thèses fumeuses d’Attaran, selon le tristement célèbre principe du recteur Frémont de l’Université d’Ottawa, stipulant que «les membres des groupes dominants (ici la «race» blanche québécoise) n’ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce qui constitue une microagression» ou toute autre forme d’oppression. La chef du parti vert fédéral, Annamie Paul, fait sienne cette position. Dans ce récit fantasmagorique, c’est la revanche des «racisés» contre la nation québécoise.
Pour ce qui est de ceux qui ne font pas le lien entre Attaran et la mise en accusation constante de la société québécoise selon une grille de lecture intersectionnelle rejetant les particularités de notre histoire, ils n’ont habituellement pas conscience, qu’entre leur position et celle d’Attaran, il n’y a qu’une question de degrés. Du collectif décolonial de Québec solidaire aux progressistes du type radio-canadien, en passant par le site satyrique Le Revoir qui s’amuse à nous dépeindre comme un peuple de tarés, leur position a pour effet de graduellement remplacer l’idée de culture nationale par celle de race. Elle justifie insidieusement l’assimilation, ou du moins la conséquence pratique de leur vision du monde est-elle l’assimilation, laquelle semble offrir le plus d’outils contre le racisme.
Cette vision des choses finit également par trahir une volonté de mise au pas des institutions selon leurs propres principes idéologiques, sans soucis de cohérence. L’important, c’est de faire avancer un agenda. Pour la moindre maladresse, pour un mot mal placé, l’on voue à la mort sociale ceux qui ont le malheur de mettre le pied dans le piège à ours (blancs de préférence!), comme ce fut le cas pour Verushka Lieutenant-Duval. Et un discours explicitement haineux, comme celui d’Attaran, du moment qu’il ne vise pas les groupes désignés comme victimes légitimes et qu’il est émis par la bonne personne [«racisée», de préférence!], a, tout à coup, droit à la défense de la libre expression, de la liberté académique et de l’autonomie universitaire contre l’État. L’on trouve normal que des théories sur le «lynchage médical» québécois circulent, mais l’on exige, en même temps, que les Québécois n’aient plus le droit de mentionner l’une des œuvres les plus importantes de leur histoire contemporaine, ici Nègres blancs d’Amérique. Ce n’est là que les prémisses d’un nettoyage culturel qui compte bien aller toujours plus loin. Et cette censure se justifie selon les critères d’un peuple qui en domine un autre. Ce colonialisme culturel trahit une volonté de mise au pas de la nation québécoise.
Immigration et identification au Canada
Voilà qui nous ramène à ceux qui, bien qu’ils intériorisent une certaine part des critiques ici formulées, refusent de les diriger vers les minorités du Québec qui font le choix d’une adhésion à l’univers mental du Canada anglais. À une époque où une masse de Québécois intériorisent l’image qu’ils ont d’eux-mêmes comme celle d’une «majorité blanche», la critique à l’égard d’une quelconque minorité est automatiquement perçue comme un acte de domination, voir même de racisme. Ce serait le travail de la majorité québécoise de se remettre en question, même si ce travail contre soi remet en cause l’idée même d’une survivance minimale. Il apparaît impossible qu’une victime désignée comme-t-elle puisse elle-même imposer un acte de domination. Et c’est pourtant ce qu’elle fait lorsqu’elle devient l’alliée d’une majorité qui écrase la minorité québécoise dont la majorité n’est toujours qu’hautement relative.
Pour le comprendre, il faut plonger dans le phénomène de l’immigration comme principal mécanisme d’assimilation. Sans elle, la politique préconisée par Durham n’aurait jamais été possible. À la fin du XIXe siècle, l’immigration de masse de langue anglaise était l’outil de prédilection pour effacer le Canada-français. Au XXIe siècle, la politique migratoire canadienne ne prend plus la forme de desseins impériaux. Elle s’affirme plutôt par des seuils d’immigration élevés lorsque comparés aux autres pays de l’OCDE, dans un contexte où le Québec n’a ni les pouvoirs nécessaires en immigration, ni la capacité à appliquer convenablement les lois linguistiques qu’il se donne pour s’assurer du maintien au long terme de son caractère français. Pour reprendre la célèbre formule de René Lévesque, conservateur potentiellement d’«extrême droite» selon les critères d’aujourd’hui, « (…) Ottawa (…) y a le droit de continuer à nous noyer, c’est lui qui a le pouvoir. Mais on en a (…) un [gouvernement] à Québec pour enregistrer la noyade.»[4]
Ce n’est évidemment pas de façon volontaire que certains immigrants se joignent à la noyade. Comme tout le monde, ces gens qui décident de faire leur vie ici font du mieux qu’ils peuvent pour se construire une vie décente. L’imbrication du Québec dans le Canada leur propose une double allégeance. La canadienne semble souvent la plus rationnelle pour des gens qui veulent s’établir dans un continent anglo-saxon. Il n’en demeure pas moins, qu’en agissant ainsi, ils s’agrègent aux forces d’assimilation qui nous dominent. Ces nombreux jeunes montréalais de minorités ethnoculturelles qui ne s’identifient pas à l’identité québécoises n’apparaissent plus comme des groupes qui résistent à une oppression culturelle et ethnique. C’est plutôt l’inverse. Mais pour le comprendre, il faut se départir d’une grille de lecture strictement raciale du vivre-ensemble.
Ce constat nous fait comprendre la frustration qui émerge chez de nombreux Québécois lorsque des manifestations antiracistes ou plus généralement progressistes se déploient en anglais ou sous un bilinguisme dans lequel le français fait office de faire-valoir linguistique. Comme lors des manifestations black lives matter, ce même sentiment a émergé face aux cris de cette foule montréalaise en lutte contre l’intolérance anti-asiatique. L’on associe souvent cette réaction à une excuse pour ne pas reconnaître le racisme vécu par certains groupes, comme si l’attachement à l’identité raciale ou étroitement communautaire n’était pas lui aussi une façon de noyer le poisson de la question nationale des Québécois.
C’est qu’une manifestation, ce n’est pas quelque chose d’anodin. Elle fait partie de ces nombreux actes citoyens qui inscrivent un groupe ou une collectivité dans la vie de la cité. À force de se constituer politiquement dans la langue du conquérant, l’on finit par normaliser une situation faisant violence à cette majorité historique qui refuse de n’être que ce résidu de peuple aux douleurs pathétiques. Le choix de l’anglais est un acte politique.
Émancipation et tolérance
Les gens adhérant au progressisme ambiant ont souvent le réflexe sain de dénoncer certains comportements racistes ou intolérants à l’endroit de minorités qui s’intègrent difficilement à la culture nationale. Là où ils se trompent, cependant, c’est lorsqu’ils associent systématiquement ces actes à une certaine puissance ou domination de la culture québécoise entendue comme corps politique.
Au contraire, la xénophobie au Québec prend des proportions à la hauteur de l’impuissance collective de son peuple. Il faut mal comprendre les processus de soumission coloniale pour y avoir là le signe d’une quelconque puissance. Frantz Fanon l’a très bien démontré dans ces travaux sur les populations colonisées du nord de l’Afrique. Face à l’impuissance, à l’impossibilité d’avoir un quelconque contrôle concret sur ses destinés, les peuples soumis ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes et à chercher la puissance où ils peuvent la trouver, aussi insignifiante puisse-t-elle être. Il s’y incruste un état d’esprit réactionnaire, obscurantiste et intolérant à l’endroit de ce qui diffère de ce que ces collectivités veulent conserver.
Le Québec n’est jamais aussi intolérant que lorsqu’il est acculé aux bords d’un précipice d’oblitération culturelle et linguistique. Ce sont durant les années de survivance et d’exploitation économique que les Canadiens-français se sont pour longtemps enfermés dans un esprit de clocher où endogamie rimait avec obscurantisme. En sens contraire, à mesure que le peuple québécois s’émancipe, à mesure qu’il s’ouvre sur le monde. C’est ce qui s’est observé durant la Révolution tranquille et à l’aube des deux référendums. Au fond, lorsque les Québécois se braquent face à ce qu’ils ne connaissent pas, c’est qu’ils craignent qu’on leur «arrache l’âme», pour reprendre l’expression de René Lévesque. Ce qu’ils veulent, c’est qu’on les respecte dans leur combat inouï pour la simple existence. Et au Québec, le «c» et le «t» du mot «respect» sont muets.
[1] Mathieu Bock-Côté, «Manifester en anglais, c’est rejeter le Québec», Le journal de Montréal, 24 mars 2021.
[2] Jean-François Lisée, «Un État post-national?», Le Devoir, 7 juillet 2016.
[3] Charles Gaudreault, «Ethnie-fiction ou réalisme démographique?», Le Devoir, 5 octobre 2020.
Du même auteur
| 2021/01/29 | La bienveillance des anges |
| 2020/11/23 | Les racistes et les idiots |