Ce qui nous délie
Abonnez-vous à notre infolettre
Édito
Coups de gueule
VIDÉO
L’AUT’JOURNAL MENSUEL
Publications
Le Québec et la guerre en Ukraine,
La tradition pacifiste québécoise mise à mal
Claude Morin,
un espion au sein du Parti Québécois
La laïcité de l'État
socle du droit des femmes à l'égalité
L'immigration au Québec
Comment faire mieux
L'indépendance et la justice climatique
La petite histoire de la Loi sur la laïcité de l'État et de sa contestation juridique
Référendum 1995 :
Documents inédits
Le fiasco de la politique
inguistique canadienne
Le pari québécois
d'une culture avant le pays
Plaidoyer pour un
Québec indépendant
Le Canada, le Québec
et la pandémie
Le territoire d'un
Québec indépendant
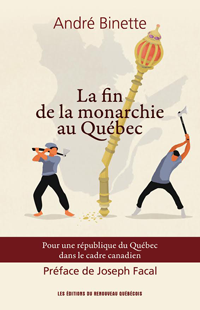
La fin de la monarchie au Québec
Une charte pour la nation
La laïcité demeure l’enjeu majeur
Les droits des peuples autochtones et l’indépendance du Québec
L'indépendance, la constitution et la constituante
La Cour suprême, le droit international et l'indépendance du Québec
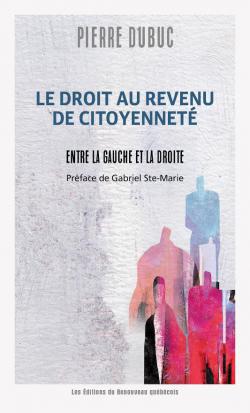

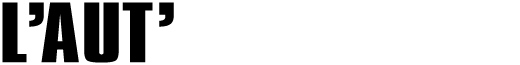






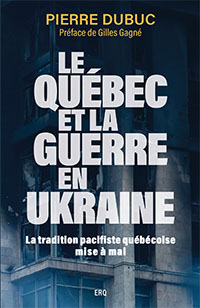
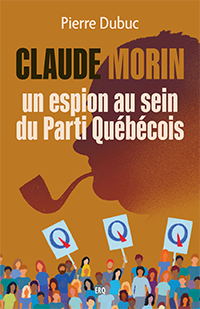
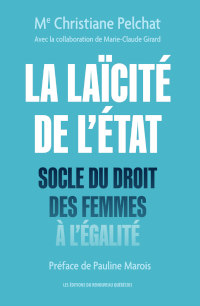
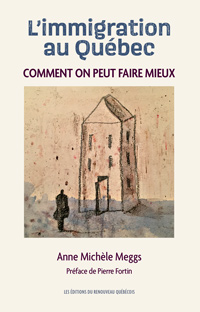
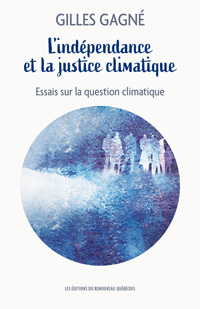


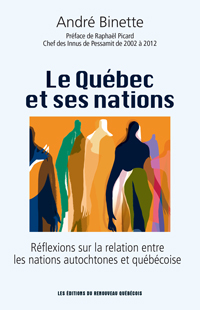
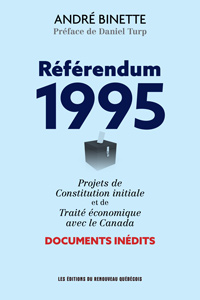



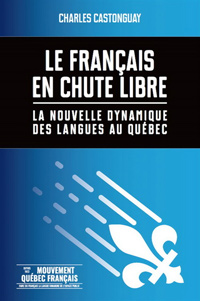


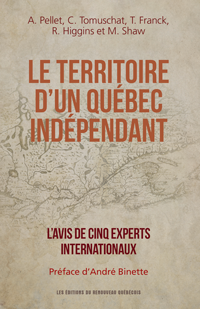
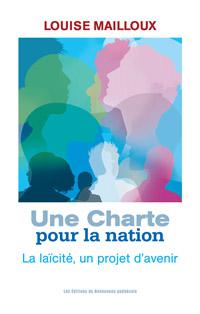
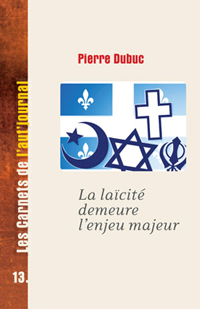
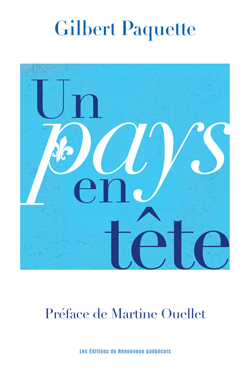

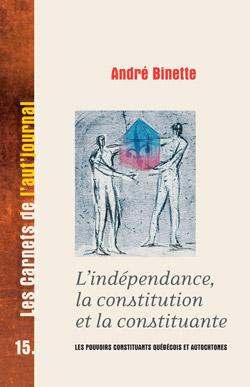
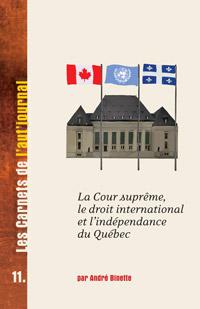
Une critique du projet de pays de Québec solidaire
En 2021, Québec solidaire a publié un essai-manifeste sous le titre Ce qui nous lie. L’indépendance pour l’environnement et nos cultures (Écosociété, 2021), regroupant des contributions de ses dix députés avec des textes de l’Ilnu Michaël Ottereyes et de l’Innushkueu Natasha Kanapé Fontaine.
Les autrices et les auteurs y affirmaient vouloir renouer avec les « raisons fortes » de l’autodétermination en l’articulant autour de l’écologie et de la culture. Leur projet y était présenté sous le signe d’une lutte commune des peuples autochtones et québécois, dont l’acte fondateur est la tenue d’une assemblée constituante.
* * *
Dans le présent ouvrage, six auteurs passent en revue leur projet de pays. Charles Castonguay commente la contribution de leur porte-parole en matière de langue française. Marie-Claude Girard souligne les contradictions dans leur politique sur la laïcité. André Binette ne se sent aucunement lié par leur approche des relations avec les Autochtones. Quant à Gilles Gagné, il analyse la pensée québécosolidaire sur l’environnement et Simon Rainville déplore la famine conceptuelle et la sécheresse historique de leur position sur la culture. Enfin, Pierre Dubuc s’attaque à l’idée que se fait Québec solidaire du Canada, de son économie et de son histoire. Une conclusion s’en dégage. Les auteurs n’ont pas trouvé de « raisons fortes » pour se sentir liés par le projet de Québec solidaire.