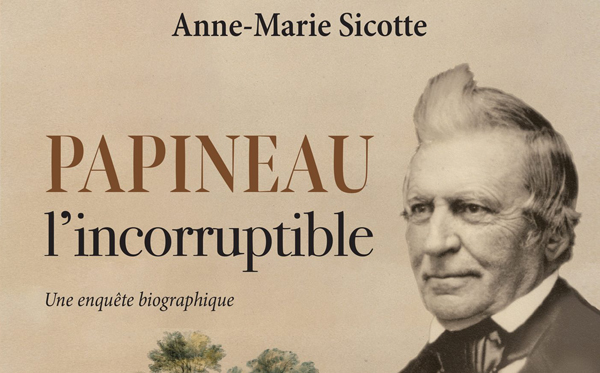
Anne-Marie Sicotte titre adroitement le second tome de sa colossale biographie de Louis-Joseph Papineau, Le président rebelle. Papineau est bien sûr le président de l’assemblée de la colonie, mais il est surtout la figure du président dont le Bas-Canada/Québec avait besoin, à l’époque, mais aussi pour la suite de notre histoire. Papineau, s’il était devenu président de la République du Bas-Canada, aurait signifié la normalité politique.
Demeuré président de l’assemblée, il symbolise notre inachèvement. Et ce presque-président d’une presque-République qui a presque failli exister, déchu après l’échec des rébellions, est toujours à la tête de notre mémoire inconséquente. Peu de personnages sont aussi mal connus dans notre mémoire collective, tant les demi-vérités et les clichés sont nombreux.
La rue du Sang
Le tome s’ouvre sur la trop méconnue élection partielle du printemps 1832 – opposant le Parti patriote au Parti constitutionnel (ou Parti anglais) – lors de laquelle le système colonial britannique enclenche la pleine mesure de la répression contre notre peuple alors que la rue Saint-Jacques, siège du pouvoir, devient « La rue du Sang » après une fusillade perpétrée par l’armée britannique. Cette émeute inventée par le pouvoir colonial, selon le titre du livre de James Jackson qui a étudié en détail cet événement, fait entrer les Patriotes dans l’époque où nous devenons « un pays en résistance ».
Ce pays s’en prend « aux fantômes de justice » (Julie Bruneau-Papineau) créés par le Parti constitutionnel et la Clique du Château, dénonçant la corruption, le favoritisme et le despotisme jusqu’en 1837. Défilent les McGill et Molson et autres voyous dans leurs plus beaux atours colonialistes dignes du Temps des bouffons de Falardeau, qui manigancent contre les droits des francophones et la démocratie que veulent instaurer les Patriotes.
Malgré cela, Papineau s’en tient à une lutte « par les voies légales, sous la direction et la protection de la métropole », rappelle la biographe. Il n’est toujours pas prêt à couper les ponts puisqu’il tient en estime la Grande-Bretagne et croit encore en partie que le problème du Bas-Canada vient uniquement de la Clique, plutôt que du système colonial. D’autres événements, comme les tentatives d’union des deux Canadas, les fraudes et les violences électorales (qui vont jusqu’au meurtre) et les attaques d’orangistes contre les maisons des Patriotes, le pousseront à mener son parti vers une voie encore plus revendicatrice. Devant tant de haine, Papineau demeure stoïque et digne. Ses interventions sont dures, mais sans calomnie, alors qu’il se permet de plus en plus souvent de nommer directement les ennemis du peuple canadien.
Un peuple en marche
Mais ce sont surtout les élections de 1834, sommet de corruption et d’intimidation de la part des « chevaliers du terrorisme », qui pousse le parti patriote à aller plus loin. La longue gestation des 92 résolutions finit par camper définitivement les positions. Contrairement à ce que l’on a longtemps dit de leur mouvement, les Patriotes jouissaient d’un réel appui populaire. Ils remporteront près de 90% des comtés en 1834!
En plus de voter, le peuple n’est pas en reste et se montre un acteur important de sa propre histoire. Plus encore que ce qu’on pouvait lire dans le premier tome, le chef s’efface par moments de sa propre biographie afin de laisser la place au peuple qu’il mène. Plusieurs forment des comités locaux pour entretenir la flamme et poursuivre les liens avec Montréal et Québec, chose complexe pour l’époque. D’autres multiplient les pétitions (100 000 personnes!) réclamant des changements.
Ailleurs, on commence à boycotter des produits anglais, ce qui a pour effet de stimuler la production locale, et à dénoncer l’étouffement de l’agriculture patriote par la British American Land Company, qui a un quasi-monopole sur les terres, et la surpuissance des banques britanniques. Le parti patriote relaie ces questions économiques en cherchant à miner l’organisation financière de la colonie par la « guerre des subsides », c’est-à-dire par le refus de voter en faveur des dépenses (les subsides) du gouvernement.
D’autres encore cherchent à tisser davantage de liens avec toutes les communautés prêtes à vivre comme Canadiens (Québécois de l’époque), dont certains anglophones qui désapprouvent le colonialisme britannique et ses politiques racistes envers les francophones. « La vigueur du mouvement d’affirmation canadienne, couplé à la nécessité absolue d’un patriotisme inclusif, précise avec raison Sicotte, s’incarne majestueusement dans les sociétés patriotiques », dont la société Saint-Jean-Baptiste sera la plus connue. Le drapeau vert (Irlandais), rouge (Britanniques) et blanc (Canadien de souches françaises) apparaît alors, symbole de cette volonté d’ouverture. Plusieurs Irlandais seront des Patriotes convaincus, comme le docteur O’Callaghan.
Les Britanniques du Bas et du Haut-Canada s’organisent aussi de leur côté, notamment sous la gouverne de John Molson fils, ancêtre du « grand Québécois » Geoff Molson, afin de porter secours à leurs pauvres « frères opprimés de Montréal ». Sicotte a raison de s’attarder aux ennemis des Patriotes, ce que l’on ne fait pas assez souvent, comme si on ne voulait pas percevoir notre sort réel. Il est d’ailleurs consternant de constater, par le biais des très nombreuses citations d’époque, que les Britanniques semblent mieux comprendre que les Canadiens eux-mêmes que le Bas-Canada est en train d’enclencher une marche vers la guerre.
L’omniprésence de la violence
Les Patriotes tenteront de se rapprocher des réformistes du Haut-Canada, mais sans grand succès. Ces derniers protestent quand il s’agit de questions sociales, mais entrent rapidement dans le rang quand il s’agit de questions proprement politiques (le pouvoir) ou carrément ethniques. C’est encore plus vrai quand les choses commencent à chauffer à compter de 1835 et que « la factieuse minorité se fortifie » encore davantage, selon les mots de l’auteure, en raffermissant son contrôle sur toutes les sphères où elle le peut, notamment en se rapprochant de l’Église catholique, et en augmentant sa présence armée par la création du British Rifle Corps et du Doric Club, qui dira ne pas vouloir « se soumettre à la dégradation d'être sujet d'une république canadienne-française ».
Sicotte fait bien sentir l’omniprésence de l’armée et de la violence (les maisons brûlent, l’intimidation est légion, etc.) et l’omniprésence des tensions culturelles et ethniques, surtout entretenues par les Britanniques, bien avant les rébellions. Par exemple, au retour à Montréal de Colborne, violent commandant en chef des troupes britanniques, le Herald demande « à tous les carabiniers, aux porteurs de manches de hache, au Doric Club, d’être à leur poste pour le recevoir en Triomphe ». Contrairement à ce que notre amnésie collective colporte, la violence armée tenait lieu de politique d’État, et le Bas-Canada s’engageait bel et bien dans une guerre civile de libération et non pas dans de simples « troubles » politiques où la violence aurait presque été un accident de parcours des bons colonisateurs britanniques.
Suit alors le moment où « le terrorisme de l’oligarchie » mène à l’affrontement militaire durant les rébellions de 1837-1838. « À l’hiver 1837, résume Sicotte, la lutte est à finir entre une faction intolérante et hégémonique, riche par corruption, et une majorité numérique inspirée par des principes de justice et d’équité ». Les résolutions Russel, de mars 1837, mettent de l’huile sur le feu en rejetant les 92 résolutions patriotes d’un peuple « ingrat » qui refuse « une soumission raisonnable à l’autorité indulgente qui le protège et soutient ». On croirait entendre les arguments des fédéralistes d’aujourd’hui. Russel, cet « Anglais dégénéré », selon la formule de Papineau qui se permet un rare écart, met la touche finale au plan de Londres : vaincre complètement les velléités démocratiques.
Papineau et les siens acceptent de plus en plus que la guerre civile arrive. Mais ils sont en retard sur la Grande-Bretagne qui fortifie ses positions depuis des années. Eux, angéliques, poursuivent leurs discussions politiques. Une lutte militaire se prépare de longue date. Les Patriotes n’ont que préparé la joute politique. Afin de gagner du temps et galvaniser le pays, ils continuent à discourir et à multiplier les projets de Constituante et de Convention nationale. Ils décident d’élargir le boycott des produits britanniques et de créer des institutions économiques canadiennes (comme la Banque du Peuple) afin de vider les coffres du régime colonial. Ceci n’est pas sans rappeler la création des Caisses Desjardins un siècle et demi plus tard.
La division des nôtres
Le gouvernement d’occupation riposte en renforçant sa domination légale, politique et militaire du Bas-Canada tout en cherchant à étouffer la rébellion naissante. Il se rapproche de l’Église catholique menée par monseigneur Lartigue, cousin de Papineau, afin de rallier le pouvoir religieux en échange de quelques cadeaux, dont un poste pour Lartigue au Conseil législatif. Comme quoi, les techniques pour acheter les collaborateurs n’ont pas beaucoup changé aujourd’hui.
Le journal Le Canadien, dirigé par Étienne Parent, se range du côté du pouvoir et appelle à la discussion. Comme quoi les journalistes peureux ne sont pas nés hier. La division de notre peuple est bien amorcée et n’aura de cesse de se perpétuer jusqu’à nous. Ce sera donc un peuple divisé, trahi par une partie de ses élites, qui entrera en guerre contre un Empire puissant.
La violence réelle et symbolique lors des affrontements, sous-estimée aujourd’hui, est amplement documentée par Sicotte, qui dépeint bien la rage qui éclate lors des rébellions de part et d’autre. Les charivaris répondent aux provocations coloniales. Les rencontres pour édicter une Assemblée nationale répliquent aux politiques racistes, autoritaires et corrompues.
Chaque petite incartade des Patriotes, explique la biographe, est montée en épingle par la Clique qui prétend, à l’automne 1837, à une « pseudo-révolte des Fils de la Liberté », c’est-à-dire l’organisation militaire patriote. Comme en 1832 (et en 1918 et 1970 subséquemment), le pouvoir colonial invente une insurrection afin de mater les nôtres. C’est la même méthode utilisée partout dans l’Empire, de l’Irlande à l’Inde.
Passons rapidement sur les rébellions elles-mêmes, généralement mieux connues, mais dont Sicotte résume habilement l’essentiel. La Grande-Bretagne se sait en guerre alors que les Patriotes semblent mal comprendre l’étendue de ce qui se joue : il ne s’agit plus d’une autre menace, mais de la raison d’État qui matera une fois pour toutes ce peuple ignorant.
Une partie de la population prend peur et la division du mouvement s’accélère. Dans la plupart des régions, « l’organisation patriote fait défaut », précise la biographe : à Saint-Eustache, par exemple, « les résistants n’ont construit ni tranchées ni fortifications ». Comme si les discours patriotes en chambre ne devaient pas être appuyés par une organisation concrète. Le mouvement patriote n’était pas une organisation militaire prête à se défendre par d’autres moyens.
Désarmés devant le réel
Pourtant, on sait que la guerre est la poursuite de la politique par d’autres moyens, comme le disait Clausewitz. Il semblerait que les Patriotes n’étaient déjà pas pleinement politiques, qu’ils étaient déjà en partie désarmés devant le réel parce qu’ils étaient les héritiers d’une histoire de dépendance coloniale dès la Nouvelle-France. Néanmoins, ils luttent courageusement et la haine entre Canadiens et Britanniques augmente. Chénier, De Lorimier et d’autres méritent d’appartenir à notre mémoire collective, malgré leurs insuccès.
Mais nous utilisons encore des euphémismes lorsque l’on parle de l’événement lui-même. Sicotte écrit que les habitants « ont vu la soldatesque se comporter comme lors d’une guerre de conquête d’une nation ennemie ». Ils ne se sont pas « comportés comme ». Ils étaient en guerre de conquête, la bonne cette fois.
Papineau déclarera en 1838 qu’il y aura « nécessairement haine acharnée, interminable, entre les victimes et les bourreaux ». Pourtant, les Patriotes resteront sans lendemain, tout comme 1918 et 1970. La haine s’est plutôt transformée en inconfort interminable entre ceux que l’on présentera bientôt comme des partenaires et non plus comme des victimes et des bourreaux. Tout cela même si les Anglais seront très clairs, avec le rapport Durham, l’Union et la Confédération, sur leurs intentions.
Le pouvoir britannique se dépêche, dès 1838, à effacer symboliquement Papineau : « Le chemin Papineau, explique la biographe, est rebaptisé chemin Victoria; et la place Papineau, place de la Reine ». Quelques années encore et ils prendront notre hymne national. Aujourd’hui, ils vont jusqu’à prétendre que la poutine est un de leurs plats nationaux. Notre long effacement prend une tournure radicale dès ce moment.
La plupart des Patriotes entrent dans le rang, les collaborateurs collaborent encore davantage et la vie reprend son cours presque normal en 1839. Comme si rien ne s’était produit, même si le Bas-Canada a été pillé, brûlé et violé. Et ce sera encore et toujours le cas dans notre histoire. 1919 ne donne pas l’impression que la crise de la conscription n’est vieille que d’une année tout comme on ne dirait pas que le Québec vit les lendemains de la crise d’Octobre en 1971. Comme si rien ne se produisait jamais dans ce presque-pays.
Pourtant, Maurice Séguin expliquait déjà dans L’idée d’indépendance que l’Union des deux Canadas est « la seule solution logique » et aucunement « un caprice, un châtiment temporaire pour une faute temporaire de déloyauté ». Et la Confédération, poursuivait-il, « est l’expression constitutionnelle d’un échec colonial, d’une part, et d’une réussite coloniale d’autre part ». Le Québec post-patriote demeure une colonie, quoi qu’on en dise.
Papineau entre attentisme et action
Les rébellions coïncident avec la fin de l’ascendant politique de Papineau sur son peuple, ce qui ne l’empêchera pas de demeurer « droit comme un chêne », selon la biographe, jusqu’à sa mort en 1871. À Philadelphie, à Paris, il cherche à comprendre l’échec du mouvement dont il a été la figure, la tête. Il se place dans la posture qui est la nôtre : chercher dans le passé notre inconséquence présente. Regarder l’histoire plutôt que le futur. Ressasser les échecs plutôt que préparer le prochain round.
L’après-Patriotes entame la longue histoire de notre attentisme. Nous attendons que quelque chose survienne, d’on ne sait où, d’on ne sait qui, mais sûrement pas de nous, afin de changer notre sort. Dès les lendemains des rébellions, explique Sicotte, Papineau espère : « Comme bien d’autres Canadiens, Louis-Joseph se berçait de l’espoir d’une guerre suscitée par le différend entre les États-Unis et son ancienne mère patrie concernant la frontière du Maine, mais un accord diplomatique est finalement conclu ».
À son retour d’exil, où il recherchait l’aide des États-Unis et de la France, Papineau poursuit néanmoins la lutte contre l’Union et la Confédération malgré son isolement de plus en plus grand, alors que ces anciens collègues jouent presque tous le jeu canadien. Et c’est là la grandeur désespérée de Papineau que Sicotte fait ressortir habilement. Même s’il sait l’avenir obstrué, il fustige les « faux libéraux, champions de l’oppression » dans ce « pays dirigé par d’avides crétins ».
Surtout, il cherche une voie de sortie, le plus souvent du côté de l’annexion à la République américaine plutôt que de croupir dans le statut de province d’un système centralisateur. Sa mort, voit avec justesse le journal Le Pays, symbolise la fin de l’époque « où il y eût vraiment un esprit national et un peuple canadien ». Le président de l’Assemblée d’une colonie ne sera pas devenu le président de la République.
La biographie pour démasquer le pouvoir arbitraire
Sicotte conclut sa biographie en disant qu’elle avait comme « but ultime de mettre en lumière la mécanique du pouvoir arbitraire » en recréant l’époque par une biographie « suffisamment ample pour avoir un large champ de vision ». Elle tient parole.
Les biographies ne sont pas nombreuses dans notre histoire et on ne peut qu’espérer que ce type de réussite en inspirera d’autres. La vie n’est pas vécue comme une longue interprétation théorique, malgré ce que semblent penser les universitaires qui conceptualisent tout, mais comme une série d’événements quotidiens. La lente recréation d’un univers permet d’exemplifier ce que la théorisation fait oublier : la chair de l’histoire.
On reprochait souvent à Falardeau de faire des héros trop héroïques, comme si un peuple vaincu ne devait pas avoir de héros ou, à tout le moins, devait accepter que ses héros ne l’étaient pas vraiment. Pourtant, Sicotte, comme Falardeau, montre des héros à hauteur d’homme, des figures publiques qui rassemblent les voix d’un peuple. La vie de Papineau nous rappelle qu’il ne peut y avoir d’hommes et de femmes héroïques qu’au sein d’un peuple qui accepte de vivre l’histoire.
Du même auteur
| 2024/06/20 | Avant que le Québec ne fonde |
| 2024/05/17 | Présenter le nationalisme autrement |
| 2024/04/26 | Incarner le Québec qui s’américanise |
| 2024/03/22 | Le retour du provincialisme défensif |
| 2024/03/01 | Normaliser l’anormalité politique du Québec |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/06/20 | Avant que le Québec ne fonde |
| 2024/06/07 | Je ne savais pas que j’allais me retrouver au cœur d’une guerre |
| 2024/05/31 | Libérer sa parole malgré les hivers de force |
| 2024/05/15 | Rendre accessibles nos trésors du 7e art |
| 2024/05/15 | Quand je ne serai jamais grande |



































